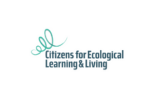Renaturation des cours d’eau : retour à l’état sauvage
Renaturer les cours d’eau est nécessaire pour lutter contre les effets du changement climatique et le déclin de la biodiversité, mais aussi pour répondre aux obligations posées par l’Union européenne. C’est aussi de cette façon que les fonctions initiales des rivières et ruisseaux, essentielles à l’Homme et à la nature, peuvent être rétablies.
Dans une publication de 2024, l’Administration de la gestion de l’eau (AGE) fait le bilan de l’état des cours d’eau au Luxembourg. Verdict : les aménagements techniques construits par l’Homme et le changement climatique ont eu - et ont toujours - de lourds impacts négatifs sur les ruisseaux et rivières du pays.
Des bénéfices pour tout l’écosystème
Avec le dérèglement climatique, les événements météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents. L’AGE rappelle les inondations de juillet qui ont marqué le Luxembourg et ses habitants. En redonnant plus d’espace aux cours d’eau qui ont été étouffés (pour servir la production alimentaire, l’énergie hydraulique ou encore la navigation), l’eau peut s’étaler dans les plaines alluviales, des espaces naturels capables de l’absorber et de la retenir en grande quantité. Renaturer, c’est donc assurer la sécurité des citoyens en réduisant le risque d’inondation en période de crue.
Évidemment, la biodiversité pâtit aussi de la détérioration des cours d’eau, puisqu’elle est en déclin au Luxembourg. Quand les niveaux d’eau diminuent, la température ainsi que la concentration de polluants augmentent et « les voies de migration dans l’environnement aquatique sont interrompues », indique l’AGE. « Les poissons et d’autres espèces aquatiques se retrouvent alors piégés dans un segment d’eau stagnante, pauvre en oxygène et fortement polluée, sans possibilité de se déplacer vers des zones plus favorables à leur survie. »
En plus d’être de véritables « foyers de biodiversité », les cours d’eau ont une autre une fonction cruciale : ils « agissent comme de grandes stations d’épuration naturelles » contribuant à la dégradation des polluants et au stockage du carbone.
Exemples de projets au Luxembourg
La renaturation vise à rétablir la continuité écologique, c’est-à-dire permettre aux organismes vivants et aux sédiments de circuler librement dans les cours d’eau. Il faut pour cela supprimer ou déraser des barrages, bassins de retenue, chutes, ou encore des canalisations.
Sur l’Ernz Noire par exemple, des projets ont été menés à Grundhof et à Breidweiler-Pont. Des barrages créaient des chutes infranchissables et des zones artificielles d’eau stagnante, perturbant ainsi la dynamique initiale de la rivière. Ils ont donc été totalement démolis et évacués - un muret ayant tout de même été conservé à Breidweiler-Pont pour assurer la stabilité de la chaussée.

L’objectif de ces travaux était de redynamiser et diversifier la structure de la rivière pour créer des habitats diversifiés pour la faune et la flore aquatiques qui ont besoin de courants variés et de substrats – comme de la terre, des roches, du sable ou du gravier – pour se développer. Pour cela, des pierres ont été placées dans le lit du cours d’eau et une rampe rugueuse (« ouvrage en enrochement permettant à la faune aquatique de franchir une différence de hauteur au sein du cours d’eau », comme défini par l’AGE) a été créée à Breidweiler-Pont.
La vallée de la Pétrusse à Luxembourg-ville bénéficie aussi d’un projet de renaturation dont la première phase s’est achevée en 2024. Le ruisseau s’écoulait jusqu’alors dans une cunette en béton rectiligne créant une « vitesse d’écoulement trop élevée » et « empêchant toute vie aquatique de se développer », explique l’AGE. Ce canal étroit qui comprimait le cours d’eau a été retiré pour le laisser retrouver une morphologie naturelle.

Alors que la phase 2 du chantier a été lancée en février 2025, la Ville de Luxembourg fait le bilan provisoire du réaménagement écologique de la vallée de la Pétrusse : « En recréant des conditions naturelles pour le cours d’eau, la renaturation a amélioré l’équilibre de la faune et de la flore. » Elle constate également que « la végétation s’est rapidement établie autour du cours d’eau » et que les « aménagements réalisés ont permis de créer des habitats, de rétablir une continuité écologique dans le cours d’eau et d’améliorer la qualité de l’eau. » Pour finir ce bilan « largement positif », la Ville ajoute : « grâce à la renaturation, l’écoulement de l’eau est plus naturel, permettant de ralentir la vitesse d’écoulement et ainsi réduire le risque d’inondation. »
L’eau à la convergence des intérêts
Améliorer l’état de ses cours d’eau est une obligation pour le Luxembourg, imposée par la directive-cadre sur l’eau (DCE) dont l’objectif est de parvenir et de veiller au bon état écologique et chimique des eaux européennes. En vigueur depuis 2000, elle « vise à prévenir et à réduire la pollution, à promouvoir une utilisation durable de l’eau, à protéger et améliorer l’environnement aquatique et à atténuer les effets des inondations et des sécheresses », détaille le Parlement européen.
Dans son rapport, l’AGE explique que renaturer les rivières et ruisseaux « passe avant tout par le dialogue », car l’eau cristallise de « multiples groupes d’intérêt : gestionnaires des eaux, agriculteurs et sylviculteurs, industriels, producteurs d’énergie, propriétaires de terrain, défenseurs de la nature et la population en général. » Un dialogue fait de compromis qui doit aboutir à l’élaboration de « solutions écologiques et économiques pour nos cours d’eau grâce à des processus de planification transparents et inclusifs. »
Léna Fernandes
Extrait du dossier du mois « inTERREdépendance »